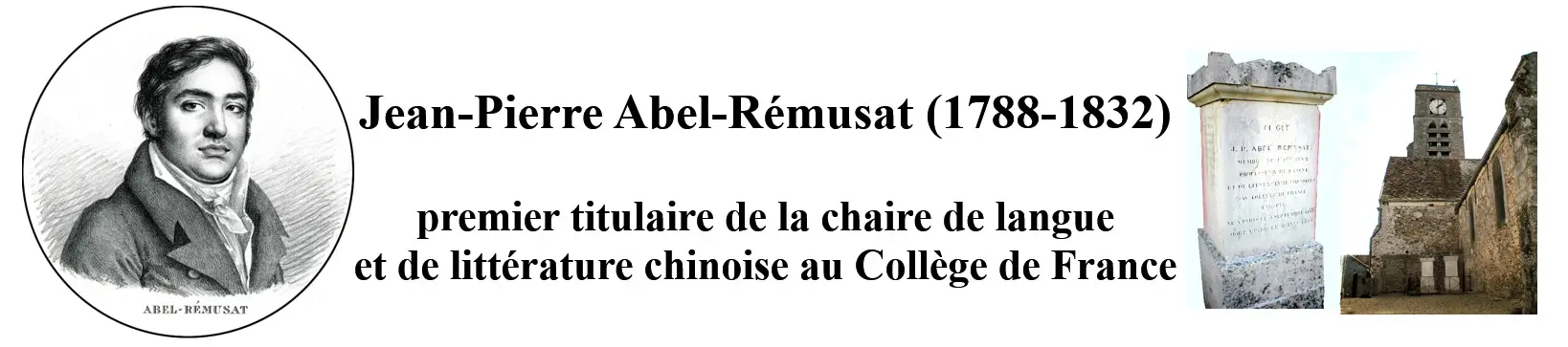
Jean Pierre Abel-Rémusat s’intéressa très jeune au monde chinois alors très mal connu. Il en apprit seul la langue, dans des conditions très difficiles, tout en poursuivant ses études à la Faculté de Médecine de Paris.
Il n’avait que 23 ans quand il publia son premier Essai sur la langue et la littérature chinoise. En 1814 est créée pour lui la première chaire de chinois au Collège de France. Il devient ainsi le fondateur des études chinoises en Occident.
Son enseignement attire à Paris des étudiants de toute l’Europe. En 1821, il publie la première grammaire (langue écrite et parlée) qui sera utilisée pendant tout le XIX° siècle. Conservateur des manuscrits et imprimés chinois à la Bibliothèque Royale, il traduit les premiers textes du Taoïsme, de Confucius, et le Foé Koué Ki, récit d’un moine chinois à la recherche des sources du bouddhisme en Inde. En relation avec savants et lettrés de toute l’Europe, il est ainsi un des principaux acteurs de la “Renaissance Orientale” qui va ouvrir au monde occidental les richesses des cultures asiatiques. La parution en 1826 d’un roman traduit du chinois, Les deux cousines, connaît un succès international : on en trouve l’écho chez Goethe, Edgar Poe, Stendhal ou Victor-Hugo !
En 1830, il épouse Jenny, fille du général Lecamus, maire de St Fargeau, propriétaire du château de Moulignon. Mais il meurt prématurément deux ans plus tard, “laissant derrière lui des disciples et une oeuvre écrite (mais aujourd’hui bien oubliée) qui mettait la France au premier rang de la sinologie dans le monde occidental”(Encycl.Unversalis).
Présentation de la première version de ces pages en 2001.
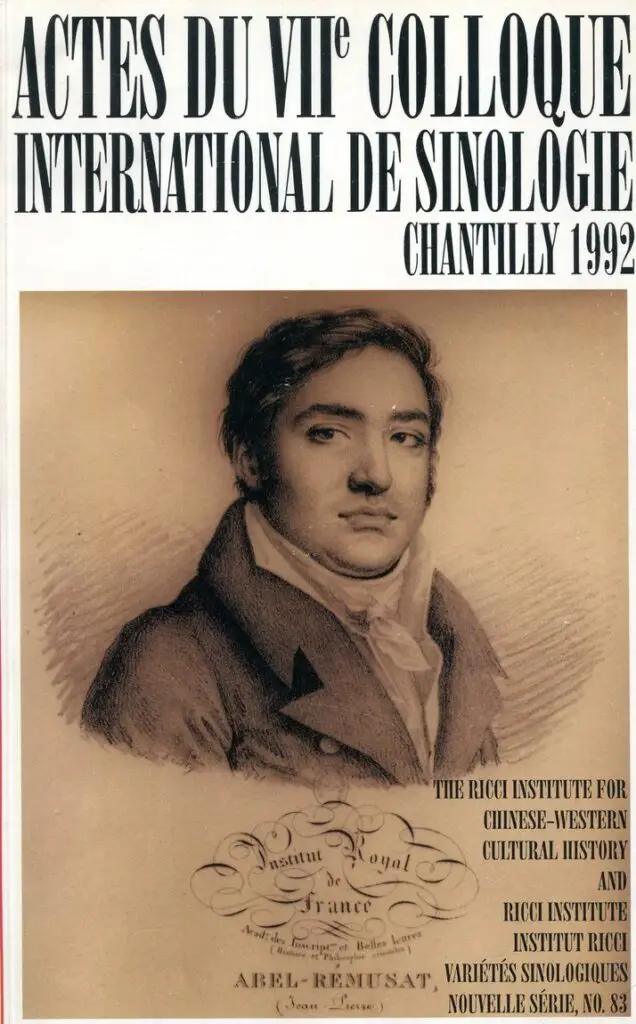
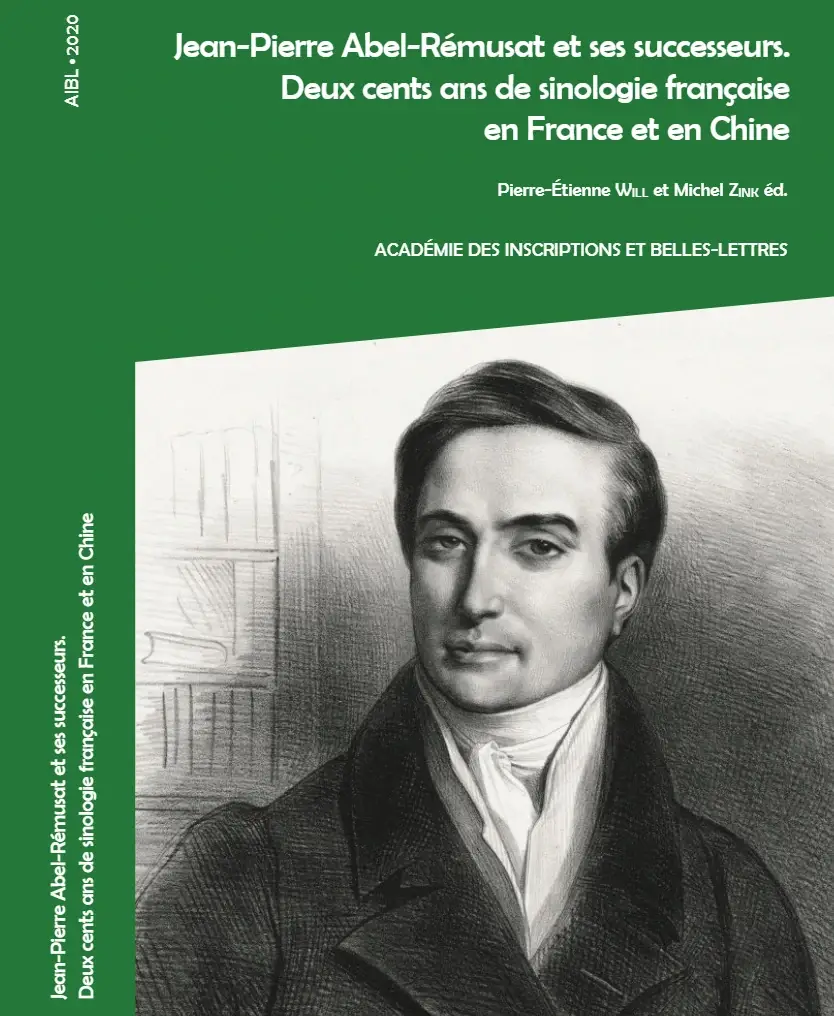
Je ne suis pas « orientaliste », à la rigueur « médio-orientalisant ». Après de très lointaines études (histoire et langues orientales), j’ai vécu et travaillé plus de trente ans dans le monde arabo-musulman du Maroc à l’Iran. C’est au moment de ma retraite, arrivé par un heureux hasard, dans un village de Seine et Marne, que j’ai découvert Abel-Remusat. Nous avons été voisins pendant plus de vingt ans puisque sa tombe se trouvait de l’autre côté du mur de mon jardin! J’ai souhaité faire plus ample connaissance et en 2001 (avec son accord tacite ?) j’ai publié sur le web quelques pages le concernant (https://jeanrobert34.com/). A la demande de quelques amis, je vais essayer de « revisiter » l’essai de 2001. J’ose espérer, qu’avec les commentaires de mes lecteurs, et si Dieu me prête vie, nous pourrons mieux connaitre cet être fascinant.